Introduction
Coopération internationale de la Suisse – Rapport annuel 2024
Why Care?
Services de base
Sauver des vies et accès aux services de bases
Sauver des vies et accès aux services de bases
Economie
Comment la croissance économique peut-elle devenir plus durable?
Comment la croissance économique peut-elle devenir plus durable?
Paix
Pourquoi avons-nous besoin de justice?
Environnement
Protéger durablement le climat et les ressources naturelles
Protéger durablement le climat et les ressources naturelles
Crises
Guerres, crises et conflits
Statistiques
Statistiques 2024Statistiques – L’essentiel en bref
Stratégie CI
Stratégie de coopération internationale (CI)
Stratégie de coopération internationale (CI)
Dépenses bilatérales par région
Le SECO est davantage actif dans les pays à revenu intermédiaire. La coopération dans les pays situés en Europe représente plus d'un tiers des dépenses bilatérales en 2024.
Dépenses bilatérales par thème et objectif
Dépenses de la DDC par secteur
Dépenses du SECO par secteur
Dépenses de la DDC réparties par région et par secteur
Dépenses du SECO réparties par région et par secteur
Climat
Gouvernance
Genre
Répartition et évolution des dépenses de la DDC
Entre 2016 et 2019, les crédits de la coopération internationale ont été impactés par des mesures d'économie.
L’augmentation des dépenses entre 2020 et 2023 est liée principalement aux crédits supplémentaires approuvés par le Parlement pour soutenir les efforts internationaux visant à atténuer les effets de la pandémie de Covid-19, de même que pour répondre à la crise humanitaire en Afghanistan, à la guerre en Ukraine et au conflit au Proche-Orient. Le recul observé en 2024 s’explique par la diminution des moyens octroyés à la coopération internationale.
Répartition et évolution des dépenses du SECO
Entre 2016 et 2019, les moyens du SECO ont diminué suite aux mesures d'économie de la Confédération.
L'augmentation en 2022 et 2023 est notamment liée aux crédits supplémentaires octroyés en réponse à la guerre en Ukraine.
Europe
Proche et Moyen-Orient
Afrique
Asie
Amérique latine
Europe
Depuis le début de l’agression militaire de la Russie, la Suisse a nettement revu à la hausse son soutien à l’Ukraine et se mobilise en faveur des personnes touchées par le conflit.
Proche et Moyen-Orient
Afrique
L'aide humanitaire met en œuvre des programmes dans la Corne de l'Afrique, au Sahel, en Afrique centrale et en Afrique australe. Elle est active dans différents domaines tels que le renforcement de la résilience aux effets de la sécheresse, la protection des civils dans les conflits armés, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et à l'assainissement.
En Afrique du Nord, l’engagement de la Suisse vise à contribuer à une région plus inclusive, prospère et pacifique.
Asie
Les activités de la DDC en Asie de l’Est et du Sud se concentre sur des pays et régions affichant des taux de pauvreté multidimensionnelle encore très élevés, par exemple en termes de revenu, de sécurité ou d’accès limité aux services de base.
La coopération au développement économique du SECO apporte un soutien au Vietnam sur la voie d’une croissance durable et portée par le marché. Les activités en Indonésie contribuent à surmonter les défis en matière de développement durable et à rendre son économie plus compétitive, résiliente, équitable et efficiente dans l’utilisation des ressources.
Amérique latine
Au Pérou, le SECO soutient principalement le développement des structures économiques, la compétitivité du secteur privé et l’accès aux services publics. En Colombie, où certaines régions du pays sont toujours fortement touchées par la présence de groupes armés et du crime organisé, le SECO crée des perspectives économiques et contribue ainsi à une paix durable.
Aide publique au développement (APD) de la Suisse
La Suisse en comparaison internationale APD 2024
En termes de volume financier, les plus grands contributeurs sont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et la France. La Suisse se situe à la 11ème place du classement en montants absolus.
Evolution du taux d'APD/RNB de la Suisse de 2015 à 2024
L'octroi de moyens supplémentaires pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et répondre aux crises en Afghanistan, en Ukraine et au Proche-Orient, couplé à l'augmentation des coûts de l'asile, entraîne une augmentation soutenue de l'APD entre 2020 et 2023.
Le recul observé en 2024 s’explique par la diminution des coûts de l’asile comptabilisés dans l’APD et la réduction des moyens octroyés à la coopération internationale.
Evolution de l'APD suisse de 2015 à 2024
Evolution de l'APD multilatérale de la Suisse de 2015 à 2024
Les contributions aux organisations non gouvernementales internationales, y compris le Comité international de la Croix-Rouge, sont considérées comme de l'APD bilatérale (et non multilatérale).
La Suisse s’engage dans l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)
Informations complémentaires :
EITI Progress Report 2024 (PDF) (en)
Soudan : une crise loin des projecteurs
- Plus de 15 millions de déplacés, dont 3,9 millions réfugiés dans les pays voisins, notamment au Tchad, au Soudan du Sud et en Egypte.
- Près de 25 millions de personnes – 50% de la population - souffrent d’insécurité alimentaire aigüe, avec des foyers de famine dans plusieurs régions.
- 30 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire.
A ces chiffres s’ajoutent le choléra qui continue de se propager et des violences sexuelles à grande échelle, ciblant les femmes et les filles.
Depuis avril 2023, la Suisse a alloué 128 millions de francs, répartis entre le CICR, des organisations onusiennes et des ONG internationales. Cette enveloppe inclut 24 millions de francs, qui sera débloquée en 2025 (17 millions pour le Soudan, 7 millions pour les pays voisins).
Depuis novembre 2024, les activités opérationnelles sont coordonnées depuis l’ambassade de Suisse au Caire pour un suivi plus étroit et une réaction plus rapide face à l’évolution de la situation sur le terrain.
Des avancées concrètes ont été obtenues:
- L’ouverture de points de passage humanitaires depuis le Tchad.
- L’autorisation de vols humanitaires.
- L’adoption de mesures renforcées pour protéger les civils.
Soudan
Deux ans après le début de la crise au Soudan: un soutien plus crucial que jamais
RDC : pour que naître et accoucher ne riment plus avec danger
Or, le système de santé est défaillant : les infrastructures sanitaires sont inadaptées et insuffisantes, l’accès aux soins est limité et le personnel qualifié fait cruellement défaut.
Pour répondre à ces défis, la Suisse a lancé en novembre 2024, un nouveau projet visant à réduire le taux de mortalité chez les mères et les enfants de moins de 5 ans, ainsi qu’à lutter contre les épidémies. Financé à hauteur de 11,9 millions de francs, ce programme devrait bénéficier à plus de 8 millions de personnes.
La RDC connaît des épidémies récurrentes (choléra, rougeole, paludisme, Ebola). Avec plus de 18’000 cas confirmés et plus de 1’700 décès entre janvier 2024 et mars 2025, la RDC est le pays le plus touché par le virus Mpox. Grâce à ce projet, la Suisse soutient la lutte contre ce virus en renforçant la surveillance, en encourageant des comportements sains et en fournissant des kits médicaux.
Informations complémentaires :
Le portail du Gouvernement suisse : La Suisse lance un projet pour réduire la mortalité maternelle et infantile en RDC
Site web DFAE : Crise humanitaire en République démocratique du Congo : la Suisse met à disposition trois millions de francs
Aide humanitaire : Moyen-Orient
- 69 millions de francs en deux tranches pour des organisations suisses, le CICR, des organisations de l'ONU ainsi que des ONG internationales et, dans certains cas, locales.
- 10 millions de francs ont été alloués à l'appel humanitaire lancé par l'UNRWA pour répondre aux besoins les plus urgents dans la bande de Gaza.
La Suisse a en outre débloqué 1 million de francs pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite menée par l'ONU dans la bande de Gaza et 7 millions de francs pour l'aide humanitaire au Liban et en Syrie.
En 2024, la Suisse a poursuivi sa réponse à la crise syrienne par sa présence en Jordanie, en Turquie et au Liban, et via son bureau humanitaire à Damas.
Le bureau humanitaire à Damas a maintenu ses activités. La DDC a lancé un programme de redressement précoce avec un consortium de quatre ONG internationales et cinq agences onusiennes. Il répond aux besoins de la population syrienne en matière de revenus, de moyens de subsistance, de logement, d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
Informations complémentaires:
Site web DFAE : Situation au Proche-Orient
Ensemble pour une industrie du café durable
- Niveau économique : les familles vivant de l’agriculture doivent pouvoir gagner un revenu leur permettant de subvenir à leurs besoins.
- Niveau social : l’industrie du café doit garantir aux productrices et producteurs des conditions de travail équitables ainsi qu’un accès à la formation et aux soins, et réduire les risques de blessure.
- Niveau écologique : l’industrie du café doit protéger les forêts, promouvoir la reforestation et veiller à générer zéro émission nette.
Informations complémentaires :
Site web : Platforme suisse de café durable
Pas de paix sans santé mentale
Orest Suvalo
Psychiatre et responsable du projet
Mental Health for Ukraine
Informations complémentaires DDC :
La santé mentale : Une composante négligée de la paix
La santé mentale, pierre angulaire d’une paix durable
Un nouvel essor pour le cacao hondurien
« Le comité national a permis de concentrer les efforts et d’améliorer la gouvernance du secteur », a déclaré Walter Reithebuch, représentant de la DDC au Honduras. « Ces progrès visibles n’auraient pas pu être réalisés sans la collaboration entre les producteurs, les coopératives, les autorités et les entreprises du secteur privé telles que Halba, l’un des plus grands producteurs de chocolat de Suisse. », a-t-il ajouté.
- Surfaces cultivées : nouvelles cultures sur 1545 ha et entretien de cultures déjà existantes sur 1230 ha, soit un total de 2775 ha.
- Des producteurs plus forts : 2245 producteurs ont bénéficié du programme.
- Hausse de la productivité : la productivité est passée de 130 à 495 kg par ha dans les plaines et à 310 kg par ha sur les terrains en pente.
- Exportations : en 2024, le Honduras espère produire plus de 2000 tonnes de cacao.
Informations complémentaires :
Site web HALBA (en): Sustainability from cultivation to enjoyment.
Programme pour l’Ukraine
Elle a par exemple contribué à moderniser le réseau de chauffage urbain de la ville de Jytomyr. Une nouvelle centrale de chauffage alimentée par des copeaux de bois remplace les anciennes chaudières à gaz.
Informations complémentaires :
Site web DFAE : Soutien de la Confédération aux personnes affectées par la guerre en Ukraine
Site web DFAE : Newsticker Ukraine
Site web DDC : Page-pays Ukraine
Site web: Switzerland+Ukraine (en)
Améliorer la résilience des entreprises ukrainiennes aux crises
En raison de la guerre, les PME ukrainiennes sont tributaires de l’exportation de leurs produits. Il est toutefois pratiquement impossible pour une entreprise seule d’accéder aux marchés étrangers. C’est pourquoi le projet du PNUD aide par exemple l’association ukrainienne des fabricants de meubles à concrétiser l’option stratégique de l’exportation. L’association a créé la marque Furniture of Ukraine et lui a donné de la visibilité sur le plan international. Elle forme et conseille ses membres, organise des présences lors de foires à l’étranger et aide ses membres à se positionner sur les marchés européens. Ses efforts ont déjà porté leurs premiers fruits : des fabricants de meubles ukrainiens ont décroché plus de 50 nouveaux contrats d’exportation, entre autres avec IKEA et XXXLutz.
Informations complémentaires SECO :
Ukraine
La DDC explore de nouvelles voies en Amérique latine
La Suisse s'est engagée dans la coopération avec Cuba dès l'an 2000. De nouvelles approches ont vu le jour dans l'administration locale et le développement rural, qui ont même été intégrées dans la législation nationale. Ainsi, la Constitution cubaine de 2019 a reconnu pour la première fois l'autonomie communale, le rôle des acteurs de la société civile et les possibilités de participation directe de la population. La production alimentaire locale a également été renforcée, tout comme la création d'organisations dans le secteur privé, une nouveauté pour le pays.
Après la crise politique de 2004 et les graves phénomènes naturels de 2005, la Suisse a lancé un programme humanitaire en Haïti. Au cours des années suivantes, le pays a connu plusieurs catastrophes. La Suisse a soutenu la construction d'écoles, d'abris d'urgence et de logements antisismiques. En collaboration avec des partenaires locaux, elle a développé des méthodes de construction, des formations et des normes qui sont aujourd'hui inscrites dans les règlements de construction haïtiens. Les banques internationales de développement s'inspirent désormais de ces modèles suisses pour financer des projets d'infrastructures sociales dans le pays.
Depuis les années 1980, la Suisse encourage la participation locale en Bolivie. Grâce à des programmes de décentralisation et de participation citoyenne, les groupes défavorisés, en particulier les communautés autochtones, ont été davantage associés aux processus politiques. Cela a contribué significativement à la démocratie dans une société marquée par les inégalités. Au cours des deux dernières décennies, l'accent a également été mis sur la promotion de l'agriculture et la garantie des revenus des petits agriculteurs. Parallèlement, des projets ont été mis en œuvre pour renforcer la résilience face au changement climatique et améliorer la gouvernance.
Au Nicaragua, la Suisse a largement contribué à améliorer les conditions de vie grâce à son soutien dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Au cours des deux dernières décennies, l'accès à l'eau potable, à des installations sanitaires et à la protection contre les phénomènes naturels liés au climat ont été au cœur de la coopération.
L'approche, qui consiste à planifier et à mettre en œuvre des projets en collaboration avec les communautés locales, s'est avérée particulièrement efficace. Les femmes et les jeunes ont joué un rôle important dans ce contexte. Leur participation active a été déterminante pour garantir la pérennité des projets.
La Suisse est active au Honduras depuis 1981. En collaboration avec les autorités locales et des partenaires privés, elle a soutenu la culture et la commercialisation du cacao, du café et des crevettes. Entre 2013 et 2017, cette aide a permis de créer quelque 30 000 emplois. Le secteur du cacao, en particulier, a connu un essor ces dernières années. Le chocolat issu du commerce équitable du Honduras a trouvé son marché et est aujourd'hui vendu dans les rayons des supermarchés suisses. La coopération suisse a également donné des impulsions dans le domaine de la bonne gouvernance.
Depuis 1997, la Suisse soutient au Pérou des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans des régions montagneuses reculées. Outre la construction d'infrastructures, la Suisse a misé sur la participation citoyenne : les communautés locales ont été associées à la gestion des systèmes d'approvisionnement en eau, ce qui a renforcé leur autonomie. Jusqu'en 2019, quelques deux millions de personnes ont ainsi bénéficié des programmes. Le savoir-faire acquis a également été mis à profit dans d'autres pays d'Amérique latine et pourrait à l'avenir profiter à des régions d'Afrique et d'Asie.
Informations complémentaires DDC :
60 ans de coopération fructueuse
Latin America and the Caribbean (en)
Du Cambodge à l'Ukraine, la Suisse soutient le déminage dans le monde entier pour un avenir sûr
- La prévention par la sensibilisation aux dangers
- L'enlèvement des mines antipersonnel et autres restes explosifs de guerre.
- L'aide aux victimes, y compris la réadaptation et la réinsertion sociale et économique des survivants
- Le travail de persuasion en faveur de l'interdiction des mines antipersonnel et des armes à sous-munitions.
Informations complémentaires :
Site web DFAE : Engagement de la Suisse pour le déminage humanitaire 2024
Site web DDC : Un pays sans mines pour un développement sans entraves
Site web DFAE : Ukraine Mine Action Conference UMAC2024
Mongolie : retour sur 20 ans de partenariat
Informations complémentaires :
Site web DDC (en) : Best Practices from Mongolia
Révolution verte
L’étroite collaboration et le climat de confiance mutuelle entre la Suisse et la Mongolie ont été des facteurs décisifs dans l’obtention des résultats. C’est grâce à cette collaboration que la loi encadrant les semences et les espèces végétales a pu être modifiée, ce qui a avivé l’intérêt des milieux scientifiques pour le développement de nouvelles espèces et stimulé les investissements privés dans ce secteur.
Après 20 années d’engagement fructueux, d’ici à fin 2024, la DDC mettra un terme à sa coopération bilatérale au développement avec la Mongolie. Elle met en place un processus de désengagement responsable et veille à ce que les résultats atteints s’inscrivent dans la durée. Des partenariats ultérieurs et d’autres formes de soutien restent possibles, dans les domaines du changement climatique, de l’aide humanitaire, de l’élaboration de politiques ou du commerce.
Informations complémentaires :
Site web DDC: L’or vert: moyen de subsistance en Mongolie
Site web DDC : 20 ans en Mongolie
DDC Podcast Spotify : "Das mongolische Kartoffel-Projekt" (de)
Un air pur – pour la santé et pour le climat
Informations complémentaires :
Site web DDC : Un air pur pour une vie plus saine
DDC Newsletter : Clean air for all (en)
Promouvoir la coopération internationale autour de l'eau : Blue Peace
L’initiative encourage le dialogue et la collaboration entre pays, secteurs et communautés pour une gestion équitable, efficace et durable des ressources en eau partagées – fleuves, lacs et nappes phréatiques.
Au cœur de Blue Peace se trouve la conviction que des solutions durables nécessitent une approche adaptée aux contextes locaux et une collaboration intersectorielle.
Blue Peace facilite le dialogue politique de haut niveau, apporte un soutien technique et promeut la recherche et les outils numériques pour les services hydro-météorologiques. L’initiative encourage également le partage de données, pour améliorer les prévisions concernant la disponibilité de l’eau et la prévention des catastrophes.
L’accès à l’eau est vital pour le bien-être et le développement économique des 75 millions d’habitants du bassin de la mer d’Aral, irrigué par les fleuves transfrontaliers Amu Darya et Syr Darya.
En février 2024, dans le cadre de Blue Peace, les ministres de l’énergie et de l’eau du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan ont inauguré deux stations hydrométriques sur les canaux du Ferghana. Celles-ci sont essentielles : « on ne peut pas gérer ce que l’on ne peut mesurer ».
Financement Blue Peace en Afrique de l’Ouest
L’Afrique abrite la majorité des bassins transfrontaliers et des aquifères. Mais le changement climatique provoque une forte pénurie d’eau. Grâce aux financements Blue Peace, des mécanismes innovants se développent pour soutenir une gestion durable de l’eau.
En partenariat avec l’Organisation pour la Mise en valeur du Fleuve Gambie, Blue Peace a soutenu l’élaboration du premier plan directeur intégré – une feuille de route multisectorielle pour la résilience climatique, la paix et la croissance, servant de modèle à d’autres bassins.
Lors de la conférence mondiale de l’eau de l’ONU en 2023, la Suisse a mis en avant les atouts de la coopération internationale pour la gestion des ressources hydriques partagées. Ses engagements politiques – notamment le financement de la coopération transfrontalière – ont apporté une contribution significative à l’agenda mondial de l’eau.
Informations complémentaires:
Site web DDC : «Blue Peace prévient les conflits et contribue à une plus grande stabilité»
Site web DFAE : Lignes directrices et plans d’action du DFAE
Stratégie CI 2025-2028
La DDC mettra fin à ses programmes de développement bilatéraux en Albanie, au Bangladesh et en Zambie d'ici à fin 2028. Elle procédera parallèlement à des ajustements dans les domaines de la formation et de la santé et réduira ses contributions à certaines organisations onusiennes.
Informations complémentaires :
Site web DDC : La stratégie de coopération internationale de la Suisse 2025-2028
Le portail du Gouvernement suisse : Coopération au développement : mise en œuvre des décisions du Parlement par le DFAE et le DEFR
Mali : quand les femmes tissent la paix
Lors de son Forum sur la paix en 2024, la coopération suisse a consacré une table ronde à la région du Sahel, avec un focus sur le Mali. Dans ce pays marqué par des années de crises, les femmes n’ont pas été associées aux discussions menant à l’accord de paix d’Alger de 2015.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la Résolution 1325 de l’ONU et le Plan d’action national 1325 du Mali, visant à renforcer les droits des femmes, leur protection et leur participation dans la réconciliation nationale.
Les cercles aident à guérir les traumatismes, à se reconstruire, à gérer les conflits pacifiquement, et renforcent l’autonomie et la résilience. Ils aident aussi à prévenir les violences basées sur le genre, en sensibilisant les jeunes femmes à leurs droits et en encourageant une cohabitation respectueuse, y compris au sein de la famille.
«C’est une grande fierté que des femmes issues des cercles de paix occupent désormais des postes au sein du Conseil national de transition».
Bintou Founé Samaké
Directrice de WILDAF/Mali et ancienne ministre.
Les cercles vont plus loin encore : des femmes et des jeunes y conçoivent des projets de vie concrets. Appelés « la paix mise en pratique », ces initiatives soutiennent le redémarrage de l’économie locale.
Bien que la situation sécuritaire et économique reste extrêmement fragile, notamment en raison de l’effondrement de l’accord de paix, les cercles demeurent un instrument essentiel pour encourager les femmes à devenir des actrices et à jouer un rôle actif dans la promotion de la paix et la reconstruction du pays.
Informations complémentaires :
Site web DDC : Mali
What is Peace?
La promotion de l’entente internationale est l'une des priorités de la politique étrangère suisse, qui continue de jouir d'une grande confiance dans ce domaine. L’IC Forum a démontré la nécessité d'adopter une approche déterminée et réaliste à l'égard des zones de conflit telles que l'Ukraine, Gaza et le Soudan, mais aussi dans des conflits peu couverts dans les médias.
L’IC Forum a mis en évidence un autre atout de la Suisse : sa capacité à réagir avec souplesse à des situations de conflit très instables en déployant toute une gamme d'instruments et en les combinant efficacement : médiation, consolidation de la paix, coopération au développement, coopération économique, aide humanitaire et diplomatie. La Suisse aura plus de chances d'atteindre ses objectifs si elle parvient à combiner plus efficacement ses instruments de politique étrangère et à les aligner sur des questions telles que l'environnement, le changement climatique, la sécurité, les droits de l'homme, la migration, les systèmes alimentaires, la culture et la consolidation de la paix.
Malgré la situation difficile en Afrique de l'Ouest, par exemple, la Suisse continue d'obtenir des résultats en soutenant de manière équitable les acteurs locaux afin d'améliorer les conditions de vie des communautés locales grâce à une combinaison d'aide humanitaire, de promotion du développement et de consolidation de la paix. Bien que des défis nationaux subsistent, la Suisse améliore la situation de la population civile locale, leur offre des perspectives d'avenir plus prometteuses et instaure la confiance nécessaire à la négocation d’un accord de paix à plus long terme.
À l'avenir, les mécanismes régionaux et nationaux de sécurité et de prévention des conflits seront de plus en plus déployés, reprenant les tâches actuellement assurées par les missions multidimensionnelles des Nations Unies. Il est essentiel que ces mécanismes permettent à l'avenir d'assurer une sécurité humaine à tous les niveaux, et pas seulement une sécurité militaire. Cela ne signifie pas seulement l'absence de guerre, mais aussi la possibilité pour la population civile de développer pleinement son potentiel, par exemple grâce à une bonne gouvernance, à la démocratie, aux droits de l'homme et à l'éducation.
Les participants ont constaté que si certaines questions, telles que les ressources naturelles, peuvent être source de conflits, elles peuvent également faciliter une coopération pacifique. Toutefois, cela n'est possible que si les décisions relatives à l'accès à ces ressources sont transparentes et si l'ensemble de la société s'intéresse aux solutions trouvées et les soutient.
Les reportages en zone de guerre et la couverture des événements sont fortement influencés par les intérêts des gouvernements et des médias.
Mais les fausses informations se sont également répandues. Par conséquent, l'un des défis les plus importants et les plus difficiles à relever dans les conflits fortement polarisés est de garantir l'accès à des informations factuelles. Pour la paix, il est donc essentiel de soutenir les médias indépendants et de faciliter la vérification des faits.
Informations complémentaires :
Take aways IC Forum 2024 (en) (PDF)
Site web DDC : Take aways IC Forum 2025
Régions montagneuses : Adaptation@Altitude
Informations complémentaires :
Site web DDC : Renforcer la résilience des régions de montagne face au changement climatique
Site web : Mountain Research Initiative (en)
Site web : Adaptation Altitude (en)
Développement urbain intelligent à Sarajevo
Le jumeau numérique permet également d’associer la population au développement de Sarajevo. La ville a réalisé plusieurs enquêtes auprès de sa population en 2024 concernant la planification urbaine pour les années 2025 à 2040. À l’aide du jumeau numérique, des « studios mobiles » ont montré comment la ville pourrait se développer, par exemple en ce qui concerne ses espaces verts et ses infrastructures de transport. Les avis reçus de la population ont ensuite été intégrés dans la planification.
Informations complémentaires :
Site web SECO : Développement urbain et infrastructures
Aide humanitaire en cas de catastrophe environnementale
Informations complémentaires DDC :
Vietnam
Amazonas
Zimbabwe
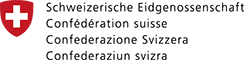




















 Coopération internationale de la Suisse – Rapport annuel 2024
Coopération internationale de la Suisse – Rapport annuel 2024




























































































































































